|
|
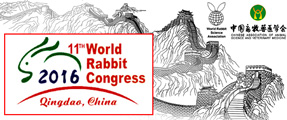
31 janvier 2017 - Journée
d'étude ASFC «Qingdao -Ombres & Lumières»
|
|
Utilisation
des matières premières et alimentation
Les apports lors du 11ème Congrès Mondial de Cuniculture
par
François LEBAS* et François MENINI**
* Association «Cuniculture»,
87A Chemin de Lasserre, 31450 Corronsac, France
**MiXscience, Centre d'affaires Odyssée, ZAC Cicé Blossac,
35172 Bruz, France
|
| INTRODUCTION |

Les 2 orateurs pendant
leur exposé |
Trente
et une communications (1 rapport de synthèse franco-belge et 30
communications courtes) ont été présentées
dans la section "Aliment et Alimentation", dont 8 françaises.
Mais plusieurs communications concernant directement les possibilités
d'utilisation de matières premières ou les techniques d'alimentation,
ont été présentées dans d'autres sections
en raison des effets principaux étudiés. Elles ont également
été intégrées à notre analyse pour
leur partie concernant la relation aliment-performances.
Par ailleurs, pour
l'étude des matières premières utilisées
pour la constitution des aliments expérimentaux, toutes les communications
du congrès ont été potentiellement prises en considération.
Enfin, l'ensemble des communications a aussi été pris
en considération pour l'analyse du mode d'alimentation employé
lors des expériences : aliment unique ad libitum ou rationné,
et aliments sépares.
|
| 1
- LE RAPPORT DE SYNTHÈSE |

Luc Maertens et Thierry Gidenne présentant leur rapport invité
au cours du Congrès |
Le rapport
de synthèse franco-belge présenté par L. Maertens
et T. Gidenne a été axé principalement sur les moyens
d'améliorer d'efficacité alimentaire en élevage cunicole
tout en préservant la santé des animaux et en réduisant
les rejets dans l'environnement. Plutôt que de paraphraser ce travail
de synthèse, il nous a semblé préférable de
mettre ici simplement la traduction française de leur résumé
pour en donner les traits essentiels.
L'alimentation représente
la plus grande part des coûts de production en élevage.
Par conséquent, l'efficacité alimentaire, exprimée
généralement par l'indice de consommation (IC) est un
indicateur clé pour évaluer les performances et la rentabilité
d'un système d'élevage. Dans l'élevage intensif
des lapins, l'IC d'élevage (maternité + engraissement)
a diminué de 3,8 à 3,4 dans les élevages européens
au cours des 15 dernières années. En conséquence,
les rejets d'azote et de phosphore ont été réduits
d'environ 10%. Cette amélioration provient d'un progrès
conjoint en matière de contrôle sanitaire, de facteurs
nutritionnels, de stratégies d'élevage et de progrès
génétiques. Afin d'optimiser les IC d'élevage,
il faut considérer à la fois les reproducteurs (maternités)
comme les unités d'engraissement. Cette revue résume l'impact
des différentes stratégies visant à optimiser l'IC
dans des conditions de production intensive, dans lesquelles les lapins
sont alimentés exclusivement par un aliment granulé [et
de l'eau]. L'usage de reproducteurs performants se traduit par une diminution
de l'IC dans la maternité. L'utilisation appropriée après
le sevrage de régimes alimentaires avec des niveaux de nutriments
adaptés pour optimiser la santé digestive, associée
avec une restriction alimentaire, conduit à des pertes minimes
et a un impact important sur l'IC. Si les différentes exigences
en matière de fibres sont satisfaites, une augmentation du niveau
d'énergie alimentaire, en particulier à l'étape
de finition, réduit l'IC d'environ 0,15 point pour une augmentation
de 0,5 MJ d'énergie digestible. Pour l'avenir, il semble possible
d'améliorer encore l'efficacité alimentaire et donc de
réduire à la fois les intrants et les rejets dans l'environnement
pour atteindre en élevage cunicole un indice de consommation
d'élevage de 3,0 semblable à celui enregistré dans
l'élevage porcin.
Nous pouvons ajouter
à la conclusion des auteurs qu'avec un indice de consommation
proche de celui des porcins, un IC de 3,0 est déjà atteint
par les élevages français les plus performants, l'élevage
des lapins fait beaucoup moins appel à des matières premières
directement utilisables par l'homme que celui des porc (voir plus loin
dans notre rapport la composition moyenne des aliments expérimentaux
présentés lors du Congrès).
|
2
- UTILISATION DES MATIÈRES PREMIÈRES
|
| |
2.1. - Études
de matières premières ± nouvelles
|
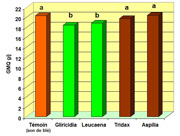
Vitesse de croissance
de lapins disposant de rations iso-azotées comportant 24 à
31% de 4 types de fourrages tropicaux
|
2.1.1.- Matières
premières tropicales et exotiques
Lors de ce congrès
peu de communications ont porté sur la valorisation de nouvelles
matières premières tropicales ou exotiques.
Nous avons cependant retenu un travail du Nigeria sur l'utilisation
du tourteau de karité, la partie de la graine restant après
l'extraction du beurre de karité. Ce produit pauvre en protéines
pour un tourteaux (10-15% /MS), limité à 2,5% en volaille,
peut être incorporé jusqu'à 8% dans l'alimentation
des lapins en engraissement en tant que source d'énergie, sans
altérer les performances de croissance (testé à
0-2-4-6-8%),.
D'autres travaux,
également du Nigeria ont confirmé les possibilités
d'utilisation des feuilles de Moringa oleifeira comme fourrage
pour les lapins. L'incorporation est possible jusqu'à 40% d'un
aliment concentré (testé avec 0-20-40%) sans altération
de la croissance, ou de la qualité des carcasses. Toutefois cette
information était déjà largement disponible grâce
à plus de 25 publications internationales. Dans le même
veine, une autre équipe nigériane a confirmé la
possibilité d'emploi de 4 autres fourrages tropicaux chez le
lapin en croissance, Gliricidia sepium, Leucanea leucocephala,
Tridax procumbens et Aspilia africana, les deux derniers
donnant les meilleures performances.
Un travail chinois
a confirmé que l'acacia jaune à petites feuilles (Caragana
microphylla), un arbuste de la famille des légumineuses (Fabaceae)
poussant dans le nord de la Chine en climat tempéré froid,
est une source fourragère potentielle intéressante pour
l'alimentation les lapins en engraissement. Dans l'étude présentée
au Congrès, elle a été testée au taux de
30% chez des lapins rex en croissance. Des résultats favorables
sur l'utilisation de cette source de fourrage chez le lapin de chair
avaient déjà fait l'objet de 2 communications en 2004
par la même équipe lors du congrès mondial qui s'était
tenu au Mexique.
Enfin un travail
égyptien a montré qu'à condition d'accroitre sensiblement
la proportion de tourteaux dans la ration des lapins en engraissement,
la bagasse (reste de canne à sucre après extraction du
jus de canne) peut sans altération significative des performances
remplacer au moins la moitié du trèfle d'Alexandrie classiquement
employé dans les rations égyptiennes comme source principale
de fibres: testé avec 0 - 9,5 et 19% de bagasse dans l'aliment.
L'IC n'est pas altéré pour une incorporation à
9,5% couplé à un apport d'un complexe d'enzymes. Les auteurs
ont cherché à démontrer que l'utilisation de la
bagasse pouvait être économique dans leur pays. Malheureusement
dans leur calcul du prix de revient de l'aliment, ils ont compté
la valeur de la bagasse comme nulle ce qui est absolument anormal. Dans
les pays ayant une industrie sucrière ou de distillerie à
base de canne à sucre, la bagasse industrielle est totalement
réutilisée sur place dans l'usine comme source d'énergie
pour fournir de la vapeur. Son prix d'intérêt est donc
lié à celui du pétrole, c'est à dire très
nettement différent de zéro. En fait, sa disponibilité
pour l'alimentation animale est quasi nulle. De ce fait les conclusions
des auteurs sur les possibilités économiques d'utilisation
de la bagasse dans leur propre pays sont erronées.
|
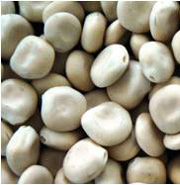
La graine de lupin
blanc peut totalement remplacer le tourteau de soja |
2.1.2.- Les matières
premières disponibles en France ou en Europe
Parmi les travaux étudiant des matières premières
déjà connues et souvent utilisées en Europe on
peut citer les 3 communications chinoises sur la pulpe de citrus (0
- 5 - 10 - 15 - 20%). Un travail tchèque sur l'utilisation de
la graine de lupin blanc a redémontré que la graine de
lupin blanc peut remplacer le tourteau de soja (taux étudié
10,5%). Un travail algérien a confirmé que la drèche
de brasserie est une source alimentaire intéressante pour les
lapins (taux testé : 30%). Parallèlement un autre travail
algérien a montré que les grignons d'olive séchés
au soleil peuvent être utilisés comme une bonne source
de fibre associée à une apport très modéré
en protéines: taux 6,4% de la MS pour les protéines brutes
avec une digestibilité de 44% seulement. Les caractéristiques
de l'olive, la météo, le procédé d'obtention
du produit et le degré d'extraction d'huiles peuvent avoir une
incidence sur l'apport nutritionnel (notamment en fibres et MG).
Un travail égyptien
a confirmé que la pulpe de tomate restant après production
des jus de tomate ou de ketchup, peut, après irradiation, être
utilisée au taux de 20%. Mais l'intérêt de l'irradiation
n'apparait pas évident au vu des performances des lapins, en
particulier en raison d'une mortalité élevée. Enfin,
un autre travail égyptien a montré que les déchets
de triage des graines de pois chiche (15 à 20% du poids des graines
brutes avant triage), ayant une composition assez proche de celle la
graine entière, peuvent être utilisés avec succès
dans la ration des lapins (testé avec 0 - 5 - 10 - 15 et 20%).
Toutefois il nous parait important de souligner que l'utilisation de
déchets de triage en général, et ceux correspondant
aux pois chiches ne font pas exception, fait courir un risque important
d'incorporation dans la ration des lapins de produits de qualité
incertaine et surtout ayant un risque fongique élevé.
|

Les glands de chêne
ont une valeur nutritive proche de celle de l'orge |
Dans un deuxième
groupe nous avons réuni des matières premières
moins classiques qui peuvent avoir un intérêt pour les
lapins. Un travail italien a porté sur l'utilisation de la pulpe
de myrtille (résidu du fruit après extraction du jus).
La communication a porté sur l'effet (favorable) sur la composition
des lipides du muscle biceps femoris mais sans fournir d'indication
précise sur les performances de croissance. Au vu des poids d'abattage
celles-ci ne sembleraient pas modifiées pour des taux d'incorporation
de 0 - 5- 10 et 15% de la ration. Une étude algérienne
sur la digestibilité de l'ensilage de maïs séché
a montré que ce produit s'il était disponible aurait un
bon potentiel comme source d'énergie pour l'alimentation du lapin
(11,1MJ/kg MS) associée à des taux de fibres assez modeste
(30% de NDF et 4% de lignine/MS) et un très faible apport de
protéines digestibles (4,4% /MS). Deux autres travaux algériens
ont aussi fourni la valeur nutritive des glands de chêne ou des
rameaux de frêne. Ces deux types d'aliment étaient connus
et utilisés pour les lapins au milieu du siècle dernier
en France (pendant la seconde guerre mondiale en particulier), mais
leur valeur nutritive précise n'était pas connue.
C'est maintenant chose faite.
|
| |
| Enfin une mention
très particulière doit être faite à un
travail tchèque sur l'utilisation de la racine séchée
de chicorée chez les lapins rationnés. Ce produit
pauvre en protéines (6,8%) mais riche en fibres digestibles
et contenant de l'inuline est considéré comme un stabilisant
du fonctionnement digestif. Après broyage, des racines de
chicorée ont été distribuées en supplément
à des lapins rationnés en engraissement. L'intensité
de rationnement était de moins en moins forte pendant la
durée de l'engraissement : 70%, 80% puis 90% de l'ad
libitum pour les périodes 36-57j - 57-64j et 64-71j
, puis à volonté jusqu'à l'abattage à
78 jours, les racines de chicorée étant distribuées
en plus à volonté. Sur l'ensemble de la période
sevrage (36j) abattage (78j) le lot à volonté a consommé
153 g d'aliment/jour, le lot rationné 117 g/j (76,5% de l'ad
libitum en moyenne) + 24g/j de racines de chicorée. Les poids
à l'abattage ont été similaires pour les deux
lots (2995-2951 g) mais l'index de risque sanitaire nettement favorable
au lot rationné + racines de chicorée : 14.1% vs 26,7%
pour le témoin à volonté. En outre le rendement
à l'abattage a été proche de celui du lot témoin
(56.8% vs 57,4%) alors qu'il était classiquement réduit
pour le lot de lapins rationnés sans additif (56.2%) servant
de témoin négatif. |
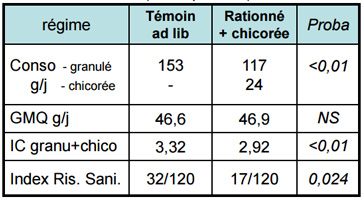
Deuxième essai avec 2 lots : témoin ad libitum
et lot rationné + racines de chicorée |
|
| |
Pour une
utilisation pratique, plus de détails sur certaines matières
premières seraient nécessaires (type de pulpe de citrus,
type et process de production des drèches de brasserie ou des
racines de chicorée,…). Il convient aussi de souligner l'originalité
du travail tchèque avec les racines de chicorée : aliment
complet rationné + matière première fibreuse, qui
mériterait d'être repris à plus grande échelle
et avec d'autres matières premières au vu des bonnes performances
techniques et sanitaires.
|
| |
2.1.3.- Nature
des matières grasses ajoutées
Un essai espagnol (Trouw Nutrition) conduit sur 660 lapins en engraissement
(34-63j) a comparé trois sources de matières grasses -
huile de soja, lécithine+huile de soja et saindoux - ajoutés
à la ration à raison de 1,5 ou 4%, étudiées.
Ceci a conduit à des aliments contenant en moyenne 3,5 ou 5,7%
de lipides (2460 ou 2660 kcal d'énergie digestible par kg pour
14,4% de protéines digestibles). L'addition de 4% de matières
grasses a significativement réduit l'ingestion (-5,5%; P<0.001)
et un peu la croissance (-3.3% ; P=0.063). Le type de lipide ajouté
n'a pas eu d'effet significatif sur la vitesse de croissance. Toutefois
il y a eu un effet favorable non significatif en faveur du saindoux
(45,1 vs 43.6 et 44,0 g/j) correspondant à une consommation d'aliment
significativement plus élevée (110 vs 104 et 105 g/j,
P=0.036). Enfin, dans cet essai le saindoux a eu un effet favorable
sur la viabilité des lapins par rapport à l'huile de soja
(3,97% vs 10,0%) contrairement à ce qui a été vu
dans d'autres essais. Le mélange lécithine+huile a donné
des résultats erratiques pour la mortalité. Il est regrettable
que la qualité des granulés n'ait même pas été
évoquée dans cet essai alors que les effets du saindoux
et de l'huile de soja ne sont pas identiques en particulier dans le
cas d'une addition de 4%, ce qui ne manque pas d'influencer la consommation
des granulés plus ou moins friable en fonction des lots.
Enfin et surtout
les conclusions de cet essai ne sont applicables que dans les pays,
dont l'Espagne, pouvant utiliser les graisses animales dans l'alimentation
de leurs animaux, car en France tout produit d'origine animale est systématiquement
exclu de alimentation animale.
|
| |
2.2.
- Estimation de la valeur nutritive des matières premières |
| |
A
côté des études in vivo sur les possibilités
d'utilisation des différentes matières premières,
un travail de compilation de la valeur alimentaire publiée dans
le littérature internationale pour différentes matières
premières (plus de 160 essais et 4 bases de données) a été
effectué par F. Lebas. Il en a déduit un système
d'équation permettant une estimation de la teneur en énergie
digestible ou de la digestibilité des protéines à
partir d'une simple analyse chimique fournissant la composition en protéines,
lipides, cellulose brute, NDF, ADF, ADL et en cendres. Bien que n'ayant
pas la précision d'une (bonne) détermination de la valeur
nutritive in vivo (étude de digestibilité), ces systèmes
d'équation fournissent une assez bonne estimation de la valeur
nutritive de matières premières ou de lots d'une matière
première non encore étudiés in vivo. Les meilleures
équations sont : |
| |
Energie Digestible lapin
en MJ/kg = 15,696 + 0,05751 MAT – 0,03929 NDF – 0,12995
ADF + 0,2003 EE – 0,2416 Mx ± 1,043 MJ/kg MS
Digestibilité des protéines % = 63,064 + 1,958
MAT + 0,757 CB – 1,918 ADL – 4,611 Mx – 0,0236 MAT²
+ 0.2296 Mx² - 0,0232 (NDF-ADF)² ± 8,10%
|
| |
2.3.
- Les différentes matières premières utilisées
dans les aliments expérimentaux |
| |
Les
auteurs de 28 communications (sur 207 communications courtes) ont indiqué
la composition centésimale des aliments expérimentaux utilisés,
le plus généralement pour des lapins en engraissement, mais
aussi pour des reproductrices ou des lapins à fourrure. Nous avons
relevé la formule des différents aliments témoin,
ainsi que celle des aliments expérimentaux ayant permis des performances
au moins similaires à celles obtenues avec l'aliment témoin
(différence non significative ou amélioration), soit au
total 58 formules.
L'hypothèse
forte que l'on peut faire est que ces auteurs considèrent pour
les aliments témoins qu'il n'y a pas de risque particulier à
employer ces matières premières dans l'alimentation des
lapins et que les matières premières expérimentées
n'ont pas de contre-indication aux taux étudiés puisque
les performances sont au moins égales à celle du témoin.
Les différents taux employés pour les 49 matières
premières concernées sont donc indicateurs des possibilités
d'emploi (tableau 1).
Les 28 communications provenaient de 7 pays (premier auteur) : Chine
(9), Egypte (6), Algérie (4), France (4), Nigéria (3),
République tchèque (1) et Italie (1)
|
| |
Principales
matières premières (MP) utilisées dans 58 formules
expérimentales avec indication de la fréquence d'emploi
(si présence dans au moins 5 formules), du taux moyen d'incorporation
lorsque cette MP est utilisée, du taux maximum d'emploi observé
et de la teneur calculée pour un aliment moyen représentant
les 58 formules présentées lors du Congrès.
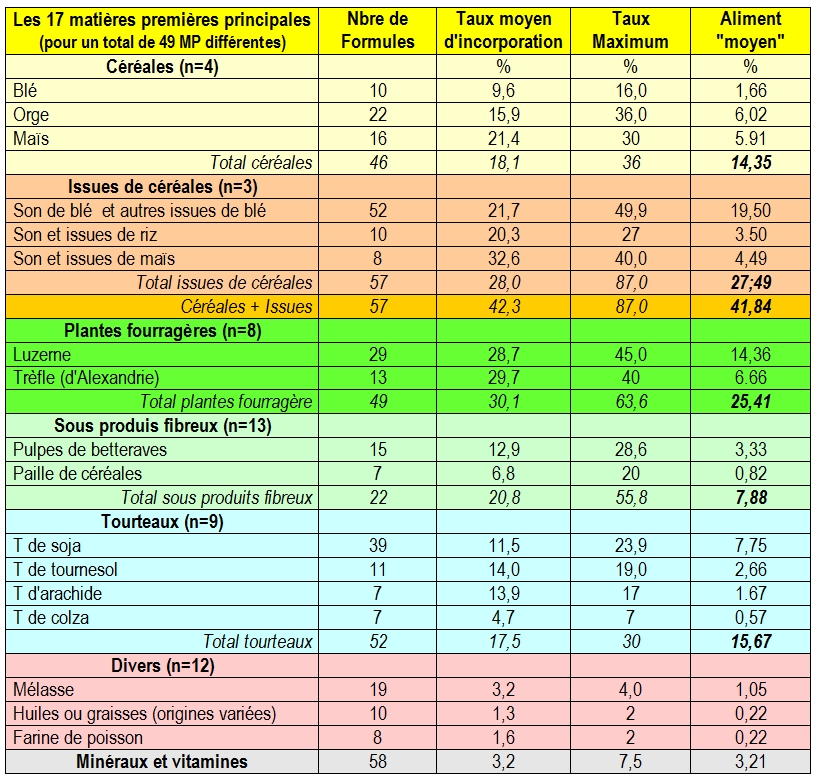
|
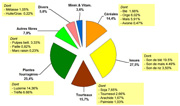
Composition de l'aliment
«moyen» sur la base des 58 formules relevées dans les
communications |
Cette
compilation de 28 communications nous a permis d'identifier 58 formules
différentes. Elles contiennent en moyenne 14% de céréales,
27% d'issues de céréales, 16% de tourteaux, 25% de plantes
fourragères, 8% de sous-produits fibreux, 5% de produits divers
, 1% de mélasse et 3% de minéraux et vitamines. Les taux
d'incorporation des 17 matières premières le plus souvent
utilisées (dans au moins 5 formules) sont réunis dans le
tableau 1, avec indication du taux maximum utilisé.
Au plan de la fréquence
d'utilisation on peut d'abord souligner la très forte fréquence
d'incorporation du son de blé : 90% des formules en contiennent
en moyenne 19,5%. Le tourteau de soja est présent dans les deux
tiers des formules expérimentales (39/58) avec un taux d'incorporation
de moyen de 11,5%. Pour sa part, la luzerne est présente dans
la moitié des formules (29/58) avec un taux d'incorporation moyen
de 28,7%. Lors du précédent congrès, la luzerne
était présente dans 64% des formules expérimentales,
avec un taux d'incorporation proche : 31%. Enfin il nous semble important
de souligner que 20% des aliments étudiés ne contiennent
pas de céréales (12/58).
Parmi les matières
premières utilisées dans moins de 5 formules et présentant
un intérêt actuel ou potentiel pour les aliments "lapin"
fabriqués en France ou en Europe, les taux maximum utilisés
sont les suivants: avoine 15%, tourteau de germe de maïs 15,2%,
sainfoin 39,6%, pulpes de citrus 21% , pulpes de tomates 20%, marc de
pomme 3,4%, marc de raisin 4,2%, anas de lin 7%, pellicules (son) de
graines de moutarde 5%, graines de lupin blanc 10,5%, drèches
de brasserie ou de distillerie 40%, graines oléagineuses entières
ou extrudées (soja, lin ou colza) 3%, farine d'aiguilles de pin
3%.
|
| |
2.4.
- Qualité des matières premières et mycotoxines |
| |
Une
matière première testée et connue pour être
parfaitement utilisable pour l'alimentation des lapins peut être
polluée en particulier par des mycotoxines malgré les efforts
faits lors de la production et/ou de la conservation. En alimentation
du bétail en général, des techniques de traitement
des matières premières ou certains additifs ont été
développés pour réduire voire même supprimer
les effets nocifs de ces mycotoxines, mais leur efficacité a rarement
été testé dans le cas précis du lapin, espèce
particulièrement sensible aux mycotoxines. Lors du Congrès,
deux études réalisées en France ont été
présentées sur cette thématique.
Un travail franco-chinois
(Anyou Biotechnology Group - Chine & Copri - France), a montré
qu'en cas de pollution fongique d'une matière première
(15% d'avoine riche en ergostérol), l'incorporation d'un adsorbant
des mycotoxines, à base de végétaux issus de la
pharmacopée chinoise, permet de réduire le taux de mortalité
(14% au lieu de 20%) sur la première phase d'engraissement (<56
jours). Cette amélioration, de l'état sanitaire a été
obtenue sans modification significative de la vitesse de croissance
sevrage-abattage (35-70j), mais avec un amélioration de l'indice
de consommation 35-70j et du rendement à l'abattage. Toutefois
ce travail ne donne pas d'indication sur la nature des mycotoxines concernées.
En effet le seul dosage de l'ergostérol mentionné par
les auteurs permet d'affirmer que l'avoine utilisée a bien subi
une pollution fongique (l'ergostérol est un composé spécifiques
des parois des cellules fongiques et des levures) mais ne donne aucune
indication sur la nature des mycotoxines concernées, ni même
la certitude qu'il y en avait bien (condition nécessaire mais
pas suffisante).
Un autre travail
présenté par MG2Mix et Copri dans la section physiologie
digestive, a montré qu'un adsorbant des mycotoxines de conception
française associé à un protecteur hépatique
(produits minéraux et organiques) a permis de réduire
significativement de 18,5% à 13,9% la mortalité constatée
sur l'ensemble de l'engraissement chez des lapins ayant reçu
un aliment contaminé par 3 trois mycotoxines identifiées
(déoxynivalénol, zéaralénone et acide tenuazonique).
L'amélioration de santé a été obtenue principalement
par réduction des troubles digestifs post-sevrage et a corrélativement
été associée à une amélioration de
la vitesse de croissance en particulier au début de l'engraissement
(40,7 vs 36,8 g/j).
|
| |
A côté
de ces effets positifs indéniables des adsorbants de mycotoxines,
il convient de souligner que les deux produits testés n'ont réduit
la mortalité d'engraissement "que" de 4 à 6
points : 14% de mortalité résiduelle contre 18 à
20% pour les 2 lots contaminés. Des essais avec d'autres dosages
ou d'autres produits sont donc souhaitables pour voir s'il est possible
de supprimer totalement ou presque les effets d'une pollution fongique
faible à modérée. En tout état de cause
des matières premières sans mycotoxine sont toujours préférables.
|
| 3
- COMPOSITION des ALIMENTS et TECHNIQUES d'ALIMENTATION |
| |
1/
Mode d'alimentation des lapins expérimentaux |
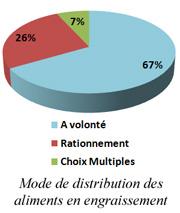 |
Avant
d'analyser les communications abordant spécifiquement les techniques
d'alimentation et la composition des aliments, il nous a semblé
intéressant de voir comment les lapins expérimentaux ont
été alimentés lors des multiples essais à
l'origine des communications du Congrès, toutes sections confondues.
Le mode de distribution
des aliments a été indiqué dans environ la moitié
des communications : 101/207. Pour les autres communications, soit le
mode de distribution n'a pas été indiqué et on
doit le regretter, soit, le plus généralement, le concept
n'était pas pertinent. Dans plus de 90% des situations, les lapins
avaient à leur disposition un aliment unique + de l'eau, cette
dernière étant toujours fournie à volonté.
Dans 9 cas au total, les lapins avaient le choix entre 2 aliments solides,
un concentré + un fourrage ou parfois plus d'un fourrage(choix
entre fourrages) mais toujours avec de l'eau de boisson à volonté.
En engraissement, les lapins expérimentaux ont été
alimentés à volonté dans les deux tiers des essais
(58 cas sur 87). Ils ont été rationnés dans le
quart des cas (23/87) et dans quelques cas restant (6/87) ils ont eu
le choix entre plusieurs aliments, généralement un concentré
rationné ou à volonté + un fourrage à volonté.
Pour les lapines en reproduction le mode de distribution des
aliments a été le plus généralement à
volonté, mais dans 2 cas sur 15, les lapines en reproduction
ont reçu une alimentation en quantité limitée,
avec ou sans un fourrage complémentaire.
Pour les lapines futures reproductrices peu d'essais, nous avons
simplement relevé 2 cas d'alimentation à volonté
et 2 cas de rationnement (comparaisons).
Enfin, les lapins adultes ou sub-adultes utilisé dans
différents essais ont été alimentés à
volonté dans 7 cas et rationnés dans 2 autres.
|
| |
2.2.
- Rationnement des lapins en engraissement |
| |
Quatre
des communications présentées au Congrès concernent
le rationnement des lapins en engraissement pendant des périodes
plus ou moins prolongées.
Un travail chinois
(Southwest University, Chongqing) a montré qu'un rationnement
quantitatif éventuellement très marqué (30% - 50%
ou 70% de l'ad libitum) pendant la semaine suivant le sevrage
de lapins Hyla, suivi d'une alimentation à volonté, n'entraîne
pas de modification significative de la vitesse de croissance au cours
des 5 semaines de l'engraissement (40-75 jours). Par contre ce court
rationnement post-sevrage permet une réduction significative
de l'indice de consommation : 2,97 en moyenne contre 3.33g/j pour le
lot ad libitum, soit -11%, sans effet significatif du niveau de restriction.
Toutefois ce travail ne donne aucune indication sur la mortalité
ou la morbidité des lapins (36 lapins par lot), ni sur le rendement
à l'abattage. Il serait intéressant que cet essai soit
répété sur un plus grand nombre de lapins et dans
plusieurs conditions d'élevage (souche, milieu, qualité
de l'aliment).
Un travail italien
(Université de Padoue) a présenté les résultats
d'un rationnement quantitatif à 80% de l'ad libitum appliqué
pendant les 3 semaines consécutives à un sevrage à
34 jours, suivi d'une réalimentation à volonté
pendant 2 semaines. Le rationnement initial n'a pas entrainé
de réduction de la vitesse de croissance globale sevrage-abattage
ni du rendement à l'abattage ou de la composition des carcasses.
Par contre il a permis une réduction de l'indice de consommation
d'engraissement de 4%. Toutefois des troubles digestifs observés
au début de l'essai ont eu pour conséquence un niveau
de consommation réel du lot soi-disant rationné très
différent du niveau théorique : 1ère semaine 87%,
2ème semaine 96% et 3ème semaine 100%, ce qui ramène
cette essai au niveau de celui de l'essai chinois présenté
juste avant.
Un essai français
(INRA Toulouse) a porté sur un rationnement à 70% de l'ad
libitum appliqué du sevrage (28 jours) à l'abattage (64
jours). Classiquement le rationnement a réduit la vitesse de
croissance (-17%) et l'indice de consommation (-15%), mais sans effet
sur la mortalité globale des lapins : 10,6% en moyenne. Cet essai
a été réalisé dans deux conditions hygiéniques
: un bon nettoyage-désinfection de la salle d'engraissement et
des cages avant l'entrée des lapins ou pas de nettoyage en dehors
d'un simple brûlage des poils. Une hygiène dégradée
(pas de nettoyage entre bandes) n'a pas eu pas d'effet sur le GMQ et
l'IC mais a été associée, de manière inattendue,
à une plus fable mortalité et morbidité 7,6% vs
16,6% (plus forte stimulation des défenses de l'organisme des
lapins en milieu plus pollué ou niveau bas d'hygiène insuffisamment
bas pour déstabiliser le sanitaire ?). Enfin dans cet essai les
auteurs ont cherché à estimer les capacités de
défenses immunitaires des lapins et ont constaté que le
rationnement tend à réduire la production des IgG par
les lapins.
Après ces
travaux sur le rationnement quantitatif, un travail français
(InVivo NSA) a montré que par rapport à un libre accès
à la mangeoire (lot ad libitum), un accès limité
à 14h/24h permet une amélioration du GMQ de 2,7% et une
réduction de l'indice de consommation de 3,36 à 3,26 (-3%),
notamment en début d'engraissement. Une mortalité nulle
pendant cette partie l'essai n'a pas permis d'estimer l'impact sur l'état
sanitaire des lapins. Par contre simultanément 2 lots étaient
rationnés quantitativement à 80% de l'ad libitum avec
1 seule ou 4 distributions par jour. La distribution unique a entraîne
les réductions classiques du GMQ (-11%) et de l'IC (3,07 vs 3.36).
Les 4 distributions / jour se sont avérées nettement moins
intéressantes qu'une distribution unique de la ration quotidienne:
plus faible GMQ et tendance à entrainer un peu de mortalité
(3.3% vs 0%). Il est dommage que les rendements à l'abattage
n'aient pas été mesurés dans cet essai.
|
| |
|
Ce travail français a confirmé
l’intérêt du rationnement en durée
: 14h de distribution, ainsi que l’effet négatif
du fractionnement des repas en rationnement quantitatif
|
|
|
| |
2.3.
- Sources et niveaux d'énergie dans la ration |
| |
Un essai
français (Techna) a été conduit pour déterminer
le rôle de l'apport principal d'énergie dans l'aliment d'engraissement
: lipides, amidon ou fibres digestibles. Cet essai s'est déroulé
dans de bonnes conditions sanitaires (1,2% de mortalité pour le
témoin et aucune pour les autres lots). A taux d'énergie
digestible identique (calculé) un aliment où un part importante
de l'énergie est apportée par des lipides (graines et huile
de colza) ou des fibres digestibles (pulpes de betteraves) donne de moins
bonnes performances de croissance ou d'abattage qu'un aliment où
l'amidon est la source principale (orge) ou surtout qu'un aliment ayant
un apport d'énergie équilibré entre les 3 sources.
Toutefois, l'amplitude observée pour les variations de vitesse
de croissance n'est que 4% alors qu'aucune mesure in vivo n'a été
faite pour vérifier que les 4 aliments expérimentaux avaient
bien des teneurs identiques au moins en énergie digestible et en
protéines digestibles. Enfin, il serait utile de répéter
cet essai dans des conditions plus classiques de mortalité telles
qu'observées sur le terrain (5-7% par exemple) pour que les effets
des sources d'énergie puissent être estimés sur l'état
sanitaire des lapins.
Un autres essai
français (INRA Toulouse), avec une alimentation séparée
mères/lapereaux, les auteurs ont étudié l'effet
de la composition de l'aliment distribué aux mères reproductrices
(120 lapines ayant donné 236 portées expérimentales)
sur leur production laitière et les conséquences sur les
performances des lapereaux qui ont tous reçu le même aliment
type engraissement de 18 à 70 jours. Par rapport à un
aliment de reproduction classique à 2,4% de matières grasses,
un aliment enrichi en matières grasses à 4,9% (origine
non précisée) distribué seulement de la mise bas
à 25 jours n'a pas modifié significativement la production
laitière contrôlée à 3 et 10 jours après
la mise bas. Par contre cette production a été accrue
sensiblement lors des contrôles à 17 jours (+26%) et à
23 jours (+16%), pour ne plus se différencier du témoin
au 29e jour de lactation lorsque les lapines étaient revenues
à l'aliment classique de maternité. Cet accroissement
temporaire de la quantité de lait disponible pour les lapereaux
a entrainé une réduction significative de leur consommation
d'aliment solide sur la période 18-25jours (7 vs 10 g/jour/lapereau)
mais a cependant permis un accroissement un poids moyen des lapereaux
à 18j (+11%) et 25 jours (+9%). Au sevrage, l'accroissement de
poids vif résiduel (+3%) n'était plus significatif.
Pour le troisième
groupe de lapines qui a reçu l'aliment type engraissement (celui
des lapereaux) de 25 jours jusqu'au sevrage de la portée à
35 jours de lactation et l'aliment de reproduction le reste du temps,
aucun écart significatif n'a été observé
par rapport au lot témoin. Dans cette étude, les 3 types
d'alimentation des mères n'ont pas modifié la viabilité
des lapereaux allaités: perte de 8,1% en moyenne au cours de
la période 3-35 j.
Après le sevrage, la croissance et l'indice de consommation ont
été similaires pour les 3 lots. Mais les lapereaux dont
la mère avait reçu l'aliment type engraissement de 25j
au sevrage, ont eu une mortalité sevrage abattage significativement
plus faible : 1,7% vs 4,7 et 5,8%. Dans la mesure où aucune indication
n'a été fournie par les auteurs sur les conséquences
de ces 3 types d'alimentation de maternité sur les performances
de reproduction des lapines, il n'est pas encore possible de tirer une
conclusion directement applicable de cet intéressant essai préliminaire.
|
| |
2.4.
- Equilibre nutritionnel de la ration |
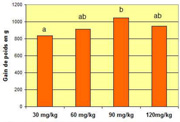
Effet de la supplémentation
en zinc de l'aliment sur le gain de poids des lapins en engraissement |
2.4.1. Apport
de Zinc
Un essai égyptien a montré qu'en période estivale
(30-32°C et 50-65% d'humidité), dans une étude portant
sur 4 taux de supplémentation en zinc (30 - 60 - 90 et 120 mg/kg
d'aliment), un apport de zinc supplémentaire de 90 mg/kg d'aliment
distribué aux lapines améliorait significativement l'ingestion
pendant la lactation (+15% d'ingéré) et le poids de portée
au sevrage à 28 jours (+22%). Par contre les 3 autres taux de
supplémentation, testés eux aussi avec seulement 15 lapines
par lot, suivies sur une seule portée, ont donné des performances
quasi identiques quelque soit le taux de zinc. Le même niveau
de zinc supplémentaire de 90 mg/kg distribué en engraissement
(20 lapins par lot) a favorisé la consommation (+9%) et la croissance
(+25%) sur une période d'engraissement d'une durée non
précisée, par rapport à la supplémentation
la plus réduite de 30 g/kg (graphique ci-contre). On doit regretter
que l'apport de zinc par les matières premières n'ait
pas été déterminé et surtout que l'essai
ait été fait avec des lapins à faible productivité.
Il vient cependant compléter les autres essais traitant du même
thème, avec des résultats certes parfois contradictoires,
mais il pourra éclairer les nouvelles recommandations suite à
la nouvelle réglementation prévue en 2017 sur les teneurs
maximales de zinc dans l'aliment
|
| |
2.4.2.
- Apport de protéines |
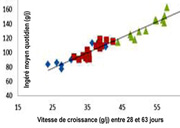
Relation entre ingestion
et vitesse de croissance de lapins de 3 lignées |
Une équipe
espagnole (Université de Valence) s'est posé une bonne
question : un aliment classique d'engraissement conçu pour des
lapins croisés destinés à la boucherie permet-il
à des lapins des lignes parentales à très haut
potentiel de croissance d'exprimer la totalité de ce potentiel
? Les auteurs ont pointé comme facteur limitant potentiel la
teneur en protéines, sans fournir de réelle justification
à ce choix. Ils ont simplement constaté la réduction
des teneurs en protéines pratiquée sur le terrain pour
réduire l'incidence de l'EEL, sans remarquer que simultanément
les teneurs en énergie digestible diminuaient aussi (plus de
fibres), ce qui maintient à peu près constant le ratio
protéines digestible/énergie digestible dans l'ingéré
des lapins. Pour étudier leur idée; il aurait été
logique de distribuer plusieurs types d'aliment avec des taux croissants
de protéines digestibles par rapport à l'énergie,
à des lapins ayant des potentiels de croissance variés
(différentes lignées) et de déterminer leurs performances
(croissance, efficacité digestive, ...). Au lieu de cela, ils
ont distribué un aliment d'engraissement unique ayant
11,1% de protéines digestibles (calculées), dont la teneur
en énergie digestible n'a même pas été précisée,
et ils ont étudié la manière dont des lapins à
vitesse de croissance différenciée valorisaient cet aliment
unique. Ils ont effectivement identifié des différences
dans l'utilisation des aliments entre les lapins ayant des croissances
différentes en analysant la relation ingéré-vitesse
de croissance.
Classiquement ils
ont montré que les lapins à croissance rapide sont ceux
qui consomment le plus. Mais ils n'ont pas déterminé par
exemple s'il y a des différences d'efficacité digestive
(digestibilité des aliments) entre les animaux à fort
et faible potentiel. Leurs observations sont relativement intéressantes,
mais cela ne répond en aucun cas à la question posée
: faut-il un aliment d'engraissement particulier pour les lapins
à très fort potentiel de croissance ?
|
| |
2.4.3. - Apport
de Vitamine E et autres additifs nutritionnels
Une expérimentation française (Copri) a testé
les effets de différentes supplémentations en vitamine
E d'un aliment de reproduction couvrant déjà largement
les besoins des animaux : la ration de témoin contenait 74 ou
80 ppm de vitamine E synthétique en sus de l'apport des matières
premières, pour des recommandations à 50 ppm au total.
Dans un premier essai incluant 4 bandes (octobre 2008 à juillet
2009), une supplémentation de l'aliment avec 51 ppm de vitamine
E extraite de l'huile de soja (apport total de 125 ppm de vitamine E),
les auteurs ont observé une tendance non significative à
l'amélioration du taux de gestation (341 portées au total
par niveau de vitamine E), sans modification de la prolificité
(10,95 nés vivant /MB en moyenne). Par contre ils ont observé
une augmentation significative de la mortalité avant servage
: 7.41 vs 4,50%, associée à une réduction du poids
moyen au sevrage (948 vs 997g). Aucune différence significative
n'a ensuite été enregistrée entre les lots après
le servage en ce qui concerne la vitesse de croissance (38,3 g/j) ou
la mortalité (9,35% en moyenne). Il reste à déterminer
si l'effet néfaste de l'apport supplémentaire de vitamine
E observé sur les lapereaux sous la mère est le fait de
l'excès de vitamine E en général (alpha-tocophérol)
ou de la source de vitamine E utilisée pour l'expérimentation
(extraction d'un produit ± pur).
Dans un second essai
portant sur 2 fois 40 portées (une série d'IA), les auteurs
ont distribué 300 g d'un "booster" répartis
sur les 15 premiers jours de lactation. Dans le lot témoin le
booster contenait 30 ppm de vitamine E et 250 ppm dans le lot expérimental.
Ces supplémentations étaient faites avec de la vitamine
E de synthèse. Le protocole appliqué n'est pas clair dans
la mesure où les auteurs mentionnent une différence significative
de prolificité entre les lots (en faveur du témoin 12,2
vs 9,4 nés vivants) c'est à dire avant même que
le booster soit distribué. Ils mentionnent ensuite une plus forte
mortalité des lapereaux avant comme après sevrage. Cet
effet négatif, en particulier en engraissement (22% de mortalité
contre 12.9% pour le témoin) semble difficilement attribuable
au booster enrichi en vitamine E consommé uniquement par la mère.
Au vu de cet essai il n'est pour l'instant pas recommandable d'ajouter
de la vitamine E dans l'alimentation des lapines au dessus de la couverture
des besoins. Cet apport supplémentaire semble en effet pouvoir
conduire à des contre-performances et en outre il a un prix relativement
élevé.
Une autre communication
relatant un travail réalisé en Egypte a montré
qu'un apport plus massif de vitamine E dans l'alimentation des lapins
en engraissement en période estivale (+200 ppm) a un effet favorable
sur l'efficacité alimentaire (IC de 4,03 vs 4,36 pour le témoin).
Un apport de sélénium (de 0,1 ppm) a aussi un effet favorable
(IC 3,74) , de même qu'un apport de tannins (0,15% - IC 3,66)
sans modification de la vitesse de croissance pour aucun des traitements.
Par contre des apports un peu différents de vitamine E (+100
ppm), de sélénium (0,2 ppm) ou de tannin (0,3%) n'entrainent
aucune amélioration de l'indice de consommation.
La conclusion
pratique à la suite de ces essais sur des additifs nutritionnels,
est qu'il faut continuer l'expérimentation pour y voir plu clair,
et pour l'instant il semble préférable de s'abstenir de
faire une supplémentation d'aliments couvrant déjà
les besoins alimentaires connus.
|
| 4
- CONCLUSION GENERALE |
| |
Pour
l'emploi des matières premières, les différentes
communications présentées lors de ce Congrès ont
surtout fourni des précisions sur les possibilités d'emploi
de matières premières déjà connues. Elles
ont fourni un éclairage complémentaire sur des limites d'emploi
et la valeur nutritive déterminée in vivo ou par
calcul à partir de la composition chimique.
Pour les techniques
d'alimentation nous retiendrons que les études expérimentales
chez le lapin en croissance se font toujours majoritairement (2/3 des
cas) avec des lapins nourris à volonté. Si plusieurs communications
ont approfondi nos connaissances sur les conséquences d'un rationnement,
et d'autres ont soulevé la question de la révision des
recommandations nutritionnelles actuelles, aucune étude n'a abordé
la composition spécifique souhaitable pour un aliment rationné.
Enfin, quelques
communications portant sur l'alimentation des lapines pendant la phase
de reproduction ont montré que l'alimentation de la mère
allaitante peut avoir des conséquences sur les performances des
lapereaux , même après sevrage, indépendamment de
l'alimentation des jeunes. Mais beaucoup de points de la relation alimentation
de la mère - alimentation des jeunes avant et après sevrage
restent mal connus et mériteraient plus de travaux de recherche.
|
| |
|